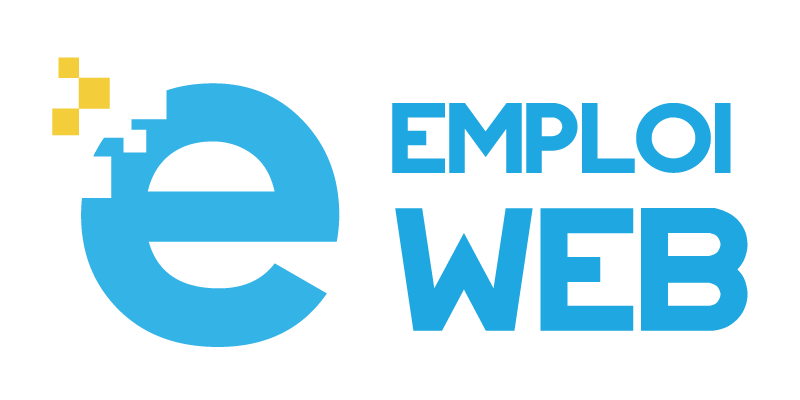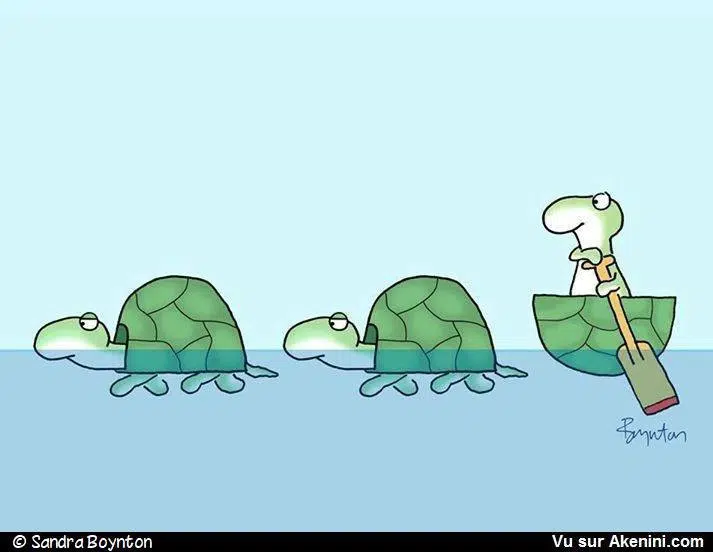Un pays peut figurer parmi les plus grandes puissances économiques et afficher, dans le même temps, des résultats scolaires à la traîne. La France est aujourd’hui confrontée à cette réalité : selon les dernières données PISA publiées en décembre 2023, nos élèves chutent dans les classements internationaux, en mathématiques comme en compréhension de l’écrit. L’écart entre les jeunes issus de familles favorisées et ceux des quartiers défavorisés ne cesse de s’élargir, dessinant une fracture silencieuse mais profonde.
Un paradoxe s’impose : la France consacre à chaque élève un budget équivalent à celui des nations les mieux classées. Pourtant, les résultats stagnent, voire régressent. Ni les multiples réformes, ni les débats passionnés sur les programmes et les méthodes n’ont permis d’enrayer la spirale. Les mêmes questions ressurgissent, les mêmes difficultés persistent. Derrière les statistiques, c’est tout un modèle qui paraît s’essouffler.
Où en est la France dans le classement PISA ?
La publication du classement PISA 2022 par l’OCDE a déclenché un véritable choc dans l’écosystème éducatif français. Longtemps considérée comme une référence dans l’enseignement, la France glisse aujourd’hui dans la deuxième moitié des pays de l’OCDE pour les compétences de ses élèves. Le chiffre qui résume la situation : 474 points en mathématiques, soit 21 points de moins que la moyenne OCDE fixée à 495. La lecture ne fait guère mieux : 474 points contre une moyenne à 487. Seul lot de consolation, les sciences, avec 487 points, restent proches de la moyenne internationale (498).
Mais c’est surtout l’explosion des inégalités scolaires qui inquiète. Les élèves issus des milieux les plus modestes accusent un retard deux fois supérieur à celui observé chez nos voisins européens. Dès le collège, la marche devient trop haute pour nombre d’entre eux. Le système éducatif français, censé offrir une seconde chance à chacun, peine à remplir sa mission : corriger les écarts, garantir un socle commun de connaissances.
Pour mieux mesurer ce déclassement, voici comment la France se situe dans les principales disciplines :
- En mathématiques : la France occupe le 23e rang sur 38 au sein de l’OCDE.
- En lecture : le pays se retrouve à la 26e place.
- En sciences : la 22e position seulement.
Le classement PISA France révèle un malaise profond. L’école n’arrive plus à compenser les inégalités de départ ni à assurer l’acquisition des compétences fondamentales. Les discussions s’enchaînent, les solutions se cherchent, mais la réalité demeure : le niveau scolaire France recule, et il faudra plus qu’un énième plan d’action pour inverser la tendance.
Pourquoi le niveau scolaire s’effondre-t-il chez nous ?
La lecture des résultats PISA ne laisse plus de place au doute : la France décroche, alors même que la moyenne OCDE reste stable, voire progresse légèrement. Plusieurs raisons se conjuguent pour expliquer cet effritement. Le système éducatif français doit faire face à une conjonction de défis démographiques, sociaux et institutionnels, qui pèsent lourdement sur son fonctionnement et son efficacité.
La formation des enseignants français est régulièrement pointée du doigt. Les nouveaux professeurs reçoivent un bagage souvent jugé trop académique, déconnecté des réalités du terrain. Dans les établissements difficiles, les classes surchargées rendent l’accompagnement individualisé quasi impossible. Les réformes, trop nombreuses, ont fragilisé les repères collectifs et installé un climat de défiance. À cela s’ajoute un sentiment d’isolement chez les enseignants, qui ont parfois la sensation d’être abandonnés face à des missions sans cesse élargies.
Plusieurs constats s’imposent, révélant les failles structurelles du système :
- Le niveau en mathématiques chute sans interruption depuis deux décennies.
- La compréhension de l’écrit accuse un retard de plus en plus marqué sur la moyenne des pays OCDE.
- Les inégalités territoriales se creusent, aggravant la fracture éducative.
Le métier d’enseignant souffre d’un manque de reconnaissance et d’une rémunération jugée insuffisante. Beaucoup expriment un réel découragement, confrontés à une école qui ne parvient plus à répondre à la diversité des profils, ni à accompagner les élèves à besoins spécifiques. La question se pose désormais sans détour : comment restaurer confiance et efficacité, alors que l’école semble à la peine pour remplir sa promesse d’égalité ?
Comparaison : ce que font (vraiment) les pays qui réussissent
Impossible de pointer un modèle unique : les pays en tête des enquêtes PISA n’ont pas tous fait les mêmes choix. Mais certains points communs ressortent nettement. Prenons la Finlande : là-bas, la confiance envers les enseignants n’est pas un slogan mais une réalité quotidienne. Leur formation est exigeante, continue, et ils participent activement à la définition des méthodes pédagogiques. Grâce à cette autonomie, ils adaptent leur enseignement aux besoins concrets des élèves, sans craindre l’expérimentation.
Au Canada, l’équité guide les politiques scolaires. Les moyens sont concentrés sur les établissements qui accueillent les publics les plus fragiles. L’accompagnement personnalisé fait partie du quotidien, limitant ainsi le décrochage. Le Québec et l’Ontario mettent l’accent sur le rythme de l’enfant, les compétences transversales, l’interdisciplinarité, autant de leviers qui nourrissent la réussite collective.
L’Allemagne, frappée par le « choc PISA » en 2001, a réagi en profondeur. Réforme de la petite enfance, apprentissage renforcé de la lecture et des mathématiques : le pays a redressé la barre par des mesures ciblées. Le Royaume-Uni mise de son côté sur la montée en puissance de la formation initiale et continue, ainsi que sur l’innovation pédagogique, pour faire bouger les lignes.
Les systèmes les plus efficaces partagent quelques ingrédients décisifs :
- Autonomie des équipes éducatives
- Accompagnement personnalisé des élèves
- Formation régulière et exigeante des enseignants
La réussite ne repose jamais sur la seule performance individuelle. Ce sont la cohésion du collectif, la valorisation de la profession enseignante, et la capacité à s’adapter sans cesse aux réalités sociales qui font la différence. À regarder de près, la France a encore du chemin à parcourir pour se hisser à ce niveau d’exigence partagée.
Réinventer l’école : quelles pistes pour sortir de l’impasse ?
L’état des lieux est sans appel : la perte de confiance dans l’école française s’accentue, dopée par des résultats PISA 2022 qui font figure de signal d’alarme. Les scores en mathématiques, lecture et sciences peinent à remonter la pente. Face à cette réalité, plusieurs chantiers sont régulièrement évoqués par les acteurs de terrain et les experts.
Revaloriser le métier d’enseignant apparaît comme une priorité. La formation initiale et continue doit monter en puissance, en exigence et en attractivité. Offrir des parcours professionnels stimulants, reconnaître la compétence pédagogique, donner une vraie marge de manœuvre dans la classe : ces leviers reviennent inlassablement dans les rapports de l’OCDE. Beaucoup d’enseignants attendent aussi une stabilité institutionnelle, pour ne plus subir de réformes à répétition qui brouillent les repères.
Alléger, clarifier et structurer les programmes : voilà un axe jugé décisif pour redonner du sens à l’école. Les pays les plus performants n’hésitent pas à concentrer les efforts sur les savoirs fondamentaux. En France, la multiplication des objectifs a parfois rendu l’ensemble illisible. Il devient urgent de repenser l’organisation des apprentissages, de les rendre progressifs et compréhensibles pour tous.
Des mesures concrètes sont avancées pour accompagner ce sursaut :
- Renforcer l’accompagnement des élèves en difficulté
- Mettre l’accent sur l’évaluation formative plutôt que sommative
- Encourager la coopération et le travail d’équipe chez les enseignants
L’école de demain ne se dessinera pas sans une communauté éducative soudée, où l’autonomie des établissements et la confiance dans les équipes prendront le pas sur la centralisation et la défiance. L’équité doit rester un fil rouge : offrir à chaque élève, d’où qu’il vienne, la possibilité de s’élever grâce à un enseignement à la fois rigoureux et bienveillant.
Changer de cap n’est pas une affaire de slogan, mais de volonté partagée. Si la France veut retrouver le goût de la réussite collective et rendre à l’école sa force d’ascenseur social, il faudra bien plus qu’un simple ajustement. Le défi est ouvert. Reste à savoir qui saura le relever, et surtout, avec quelle ambition.